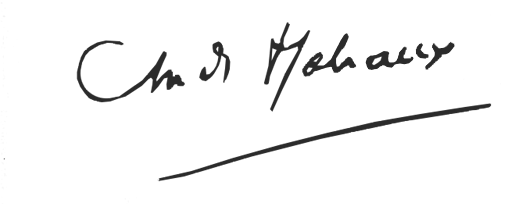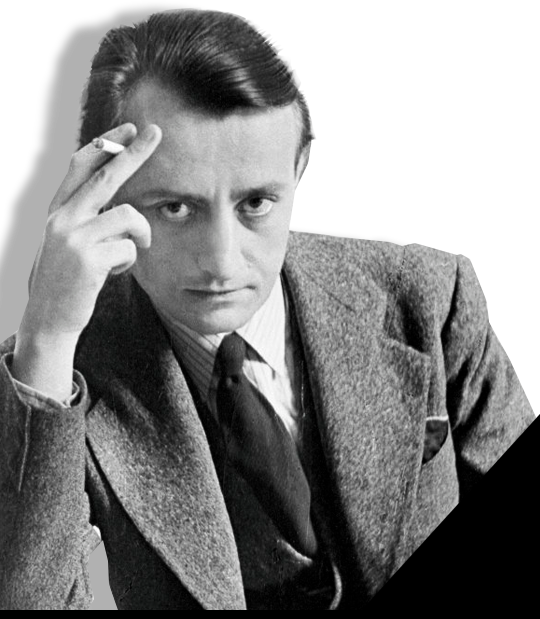Quand, il y a à peu près un an, nous commémorions, dans le maquis de Dordogne,
pour la première fois sans doute, la mort de Léo Lagrange, je ne pensais pas que la
commémoration suivante aurait lieu dans cette salle et rencontrerait tant d'amitié; ni
que, ce soir où des amis qui ont connu Léo Lagrange pendant un temps plus long que je
ne l'ai aimé, ont pu vous apporter tant de renseignements et de souvenirs, il
m'appartiendrait d'essayer de fixer devant vous l'itinéraire intellectuel du seul ministre
de France, après tout, qui soit mort pour son pays.
Après avoir parlé de Léo Lagrange adolescent, soucieux «d’unir la République de
Lénine à la République de Danton» et souligné son désir d’intervenir, à Avesnes, dont il
devint député, pour aider ses compagnons là où la loi était impuissante (rôle qui était à
ses yeux un des rôles du représentant du peuple), après avoir souligné son lien avec
l’idéologie révolutionnaire du Nord plein de survivances guesdistes, André Malraux
poursuit :
Ce lien devait faire naître chez lui ce que j'appellerai une sorte de socialisme
nietzschéen. Léon Blum a dit tout à l'heure «un Socialisme humaniste» et je me rallie
volontiers à la formule; je voudrais pourtant la préciser. Léo Lagrange qui n'était pas un
doctrinaire, qui n'a pas écrit de livres, a tout de même écrit un certain nombre de
discours; ils seront sans doute publiés un jour. Et les thèses de ces discours jouent sur
quatre mots : Vérité, Justice, Dignité, Courage.
Vous savez qu'il avait écrit : «là où il n'y a ni vérité, ni justice, il n'y a pas de
possibilité pour un parti socialiste» et que, dans sa lutte contre les communistes, il disait
que ce qui le séparait irréductiblement d'eux, bien qu'ils fussent unis dans le combat,
c'était de n'être pas d'accord sur la recherche de la vérité.
Ce qu'il y avait de consolant, c'est que lorsqu'ils avaient été pendant un certain
temps opposés sur la vérité, ils finissaient par se rejoindre sur le terrain du courage...
Cet ensemble d'idées représente bien, surtout avec l'idée de courage mise à sa
place, quelque chose qui dépasse un peu l'humanisme. Léon Blum a dit tout à l'heure
qu'une évolution générale nous permet de voir un socialisme qui se rapproche de plus en
plus d'une sorte d'humanisme et pour tout dire de libéralisme (c'est bien possible, c'est
peut-être voir le marxisme un peu largement), mais à l'époque où Léo Lagrange
défendait son idéologie, elle était assez mal vue par les doctrinaires, et il n'était guère de
parti politique alors qui acceptât de se fonder sur la dignité humaine, sur la vérité et la
justice...
Le résultat fut ceci : lorsque Léo Lagrange arriva à la Chambre des députés, sa
première intervention fut pour mettre en accusation le nouveau gouvernement qui venait
de se constituer, et qui était le gouvernement Laval; et sa seconde intervention fut pour
mettre en accusation Stavisky. C'était assez bien débuter.
Arrivé aux Sports et Loisirs, ce qu'il fit ne fut pas autre chose que l'application
méthodique des idées que j'ai essayé d'exposer. Son idée sur les sports était à peu près
celle-ci : il y a un développement des sports considérable dans tous les pays fascistes.
Ce développement consiste à supprimer toute liberté au bénéfice du sport et, par le
sport, à orienter toute la jeunesse vers la guerre. Nous, démocraties, nous sommes en
face du problème suivant : comment allons-nous conserver aux hommes leurs libertés,
leur donner par le sport la joie et ne pas les diriger par-là vers la guerre ? On a prétendu
qu'il suivait les leçons fascistes en organisant le sport; ce qu'il fit était exactement
l'inverse et pourrait se résumer en une phrase : il a essayé de créer en France un grand
mouvement de sport qui ne fût pas payé au prix du sang.
L'organisation des loisirs qu'il n'eut pas la faculté de mener jusqu'au bout
exprimait la même idéologie : par la démocratie d'une part, et de plus par les
découvertes techniques comme le cinéma, et le phonographe succédant à l'imprimerie,
la culture, qu'on le veuille ou non, devient l'apanage inévitable d'un nombre toujours de
plus en plus grand d'hommes. Il eût voulu une action de l'Etat par laquelle le chefd’œuvre,
appartenant à l'humanité, fût mis non pas à la disposition de tous, ce qui n'a
aucun sens, mais à la disposition de quiconque (et quelle que fût son origine ou sa
pauvreté), désirerait le connaître; c'est-à-dire que l'on pût trouver dans n'importe quelle
ville de province d'excellentes reproductions des chefs-d’œuvre, que l'on pût voir sans
payer; que l'on pût trouver des disques que l'on pût écouter sans payer; que l'on pût lire
des livres de valeur sans payer. Ce n'était pas autre chose, dira-t-on, que l'ancien
système des bibliothèques municipales; ce qui était autre chose c'était de l'étendre à la
totalité des œuvres humaines et surtout de vouloir associer la France tout entière à cette
volonté de culture.
André Malraux parle alors de l’action de Léo Lagrange pour l’Espagne
révolutionnaire, de son opposition à Munich et de l’appui qu’il apporta à la
Commission de l’armée aux théories du colonel de Gaulle.
La guerre vint. Léo Lagrange n'était pas mobilisable : il avait fait la guerre de
1914 comme engagé et il était parlementaire. Il s'engagea. Cet engagement a été discuté.
Il pose un problème que je n'escamoterai pas. Etait-il souhaitable qu'un des hommes qui
nous manquent le plus aujourd'hui mourût dans l'exercice d'une activité où son utilité
était assez mince : observateur dans l'artillerie ? Je crois que la question est mal posée,
et j'ajoute que je crois qu'elle n'est pas posable.
Car tout ce que j'ai essayé de vous exposer repose sur une seule idée : l'idée de la
fidélité. Léo Lagrange fut fidèle aux militants qui l'avaient entouré dès l'origine; c'est
par fidélité qu'il voulut que les sports fussent donnés à des gens sans être payés du prix
du sang; c'est par fidélité qu'il voulait une culture accessible à tous; c'est par fidélité
qu'il pensa qu'on devait aider l'Espagne sans attendre; c'est par fidélité qu'il fut
antimunichois; la même fidélité devait le contraindre à accepter cet engagement
fondamental, l'engagement qui, cette fois, allait être payé de sa vie. Il pensait que ceux
qui avaient attaqué le fascisme à l'heure où il était derrière le Rhin ou derrière les Alpes,
se devaient à eux-mêmes d'aller le combattre les armes à la main lorsqu'il était en face
de ceux qui les avaient écoutés.
Il est mort dans la fidélité, il est mort dans le courage, dans la recherche de la
vérité et dans la dignité. C'est avec ses quatre mots à lui qu'on peindrait le mieux sa
mort et qu'on pourrait répondre à la phrase de Maurice Schumann tout à l'heure : «Mon
Dieu, donnez à chacun la mort qui lui revient.» Cet homme a eu la mort qu'il eût
choisie. Aussitôt après paraissait la citation : «Officier de liaison d'un dévouement
absolu, d'un courage sans pareil, a rendu comme observateur avancé les plus grands
services. Est tombé, mortellement frappé, le 9 juin 1940, à son poste de combat, au
moment où il se préparait à détruire l'usine d'Evergnicourt, fortement occupée par
l'ennemi.»
Qu'il repose dans le cœur des siens, qu'il repose dans le cœur de ceux qui sont
dans le petit cimetière d'Avaux dont je me souviens, qu'il repose dans le cœur profond
du peuple de Paris qui, ce soir, peut-être pour la dernière fois, entendra parler de lui.
Mais, avant que tout ceci ne soit mêlé comme les galets, au rythme éternel de l'oubli, je
voudrais résumer ce qu'ont dit ceux qui m'ont précédé et vous demander, si ce nom est
jamais prononcé devant vos enfants, lorsque vous en aurez dit ce que vous en savez,
d'ajouter simplement au nom de tous ceux qui sont venus ici, au nom de tous ceux qui
sont sur cette tribune : «Ce combattant aima le Peuple de France, lui fut fidèle pour le
meilleur et pour le pire, dans la vie et jusqu'à la mort», et d'ajouter aussi quelque chose
de plus simple : «C'était un homme que nous aimions.»